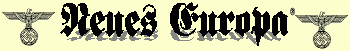
Mon Combat
ADOLF HITLER
12
La première phase du développement du parti ouvrier allemand national socialiste
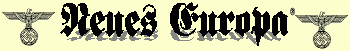
Mon Combat
ADOLF HITLER
12
La première phase du développement du parti ouvrier allemand national socialiste
Si je décris à la fin de ce volume la première phase du développ ment de notre mouvement, et si je discute sommairement une série de questions qui s'y rattachent, ce n'est pas dans l'intention de disserter sur l'esprit de notre doctrine.
Notre programme a, en effet, une envergure telle qu'il peut remplir un volume entier. J'en discuterai donc à fond dans le tome Il de cet ouvrage et j'essaierai de trouver une image de l'Etat tel que nous nous le représentons. « Nous », ce sont les centaines de mille hommes qui, au fond, partagent notre idéal, sans que chacun trouve les mots nécessaires pour décrire ce qui flotte devant ses yeux.
Toutes les grandes réformes ont, en effet, ceci de remarquable qu'elles n'ont souvent, tout d'abord, qu'un seul champion, puis gagnent des millions et des millions d'adeptes. C'est qu'elles répondaient déjà au vœu profond de milliers d'hommes impatients, lorsqu'enfin l'un d'eux s'est dressé pour proclamer leur volonté commune, et pour lever l'étendard des vieilles espérances, et, dans leur expression nouvelle, les conduire à la victoire.
Le fait que des millions d'êtres ont au fond du cœur le désir d'un changement complet des conditions de vie actuelles, prouve leur profond et douloureux mécontentement. Ce mécontentement se manifeste de mille façons différentes, chez l'un par le découragement et le désespoir, chez l'autre pat le dégoût, la colère et l'indignation, chez tel autre par l'indifférence et chez tel autre encore par un furieux désir d'intervenir. Parmi les mécontents, les uns
331 s'abstiennent aux élections, d'autres, nombreux, votent avec les fanatiques d'extrême gauche.
C'est vers ceux-là que notre jeune mouvement devait se tourner en premier lieu : car il était naturel qu'il ne tendît pas vers une organisation de gens satisfaits et repus, mais qu'il recrutât les êtres torturés de souffrances, tourmentés, malheureux et mécontents ; avant tout, il ne doit pas flotter à la surface du corps social, mais pousser des racines su fond de la masse populaire.
* Au point de vue politique, voici quelle était la situation en 1918 : un peuple divisé en deux parties. La première partie, de beaucoup la moins nombreuse, embrasse les couches intellectuelles de la nation, à l'exclusion des professions manuelles. Elle est superficiellement « nationale », en entendant par là qu'elle représente assez vaguement des intérêts qualifiés intérêts d'Etat, mais qui paraissent plutôt s'identifier avec des intérêts dynastiques.
Elle essaie de réaliser son idéal et de parvenir à ses objectifs grâce à des armes spirituelles dont l'effet est aussi superficiel qu'incomplet et qui, déjà par elles-mêmes, ont, vu la brutalité de l'adversaire, une infériorité marquée.
D'un coup violent, d'un seul, cette classe qui était encore tout récemment la classe dirigeante, fut mise à terre : tremblante de lâcheté, elle subit les humiliations que son vainqueur impitoyable voulut lui imposer.
A cette classe, s'oppose celle de la grande masse de la population des travailleurs manuels. Celle-ci est groupée en mouvements de tendance plus ou moins marxistes-extrémistes, et elle est décidée à briser par la force toutes les résistances d'ordre intellectuel. Elle ne veut pas être nationale ; elle refuse sciemment de favoriser les intérêts nationaux : au contraire, elle favorise toutes les poussées dominatrices étrangères. Numériquement, elle représente la plus grande partie du peuple, mais surtout elle contient les éléments de la nation sans lesquels un relèvement national ne peut être ni envisagé, ni réalisé.
Car, dès 1918, on devait comprendre ceci : toute ascension nouvelle du peuple allemand conduit à une aggravation des pressions étrangères sur l'Allemagne. Les conditions n'en sont pas toutefois les armes matérielles comme nos
332 « hommes d'Etat » bourgeois ont coutume de le rabâcher, mais les forces de la volonté. Des armes, les Allemands en avaient alors plus que de besoin ; s'ils n'ont pas su assurer leur liberté, c'est qu'ils manquaient de l'énergie que donnent l'instinct de la conservation et la volonté de vivre. La meilleure arme n'est que de la matière inerte et sans valeur tant que manque l'esprit qui est prêt, enclin et décidé, à la mettre en œuvre. Si l'Allemagne fut sans défense, ce n'est pas qu'elle manqua d'armes ; il ne lui manqua que la volonté de conserver ses armes pour la défense de son peuple.
Si, aujourd'hui surtout, nos politiciens de gauche s'efforcent d'imputer au manque d'armement leur politique sans conscience, toute de concessions et de trahisons, ils ne méritent qu'une réponse : « Vous ne dites pas la vérité ! Par votre politique criminelle d'abandon des intérêts nationaux, vous avez livré vos armes. Maintenant, vous essayez de présente le manque d'armes comme cause déterminante de votre lamentable misère : il ri y a là comme dans tout ce que vous faites, que mensonge et fausseté. »
J'en dirai d'ailleurs autant aux politiciens de droite : car, grâce à leur pitoyable lâcheté, la racaille juive, parvenue au pouvoir en 1918, a pu voler à la nation ses armes. Pas plus que les autres, ces Juifs n'ont droit ou raison de faire du désarmement actuel le pivot de leur politique clairvoyante et prudente (disons plutôt : lâche) ; c'est au contraire notre situation de peuple sans défense qui est le résultat de leur lâcheté. Pour résoudre la question d'un rétablissement de la puissance allemande, il ne s'agit pas de nous demander : k Comment fabriquerons-nous des armes ? u, mais : « Comment créerons-nous l'esprit qui rend un peuple capable de porter des armes ? » Quand un tel esprit souffle sur un peuple, sa volonté trouve mille chemins dont chacun conduit à une arme. Vous pouvez donner dix pistolets à un lâche, il ne tirera pas une cartouche à l'attaque ! Ils valent moins en ses mains qu'un gourdin dans celles d'un brave.
La question de la reconstitution de la force politique de notre peuple est déjà, de ce fait, une question d'assainissement de notre instinct de conservation nationale : en effet, toute politique extérieure préparatrice et toute remise en valeur de l'Etat lui-même est moins fonction des dispo-
333 nibilités en armement que de la capacité de résistance, reconnue ou supposée, d'une nation. La capacité de cohésion d'un peuple est beaucoup moins déterminée par une grande accumulation d'armes inanimées que par l'existence visible d'une ardente volonté de conservation nationale, et d'un courage héroïque jusqu'à la mort. Une association ne 'se consolide pas avec des armes, mais avec des hommes. C'est ainsi que le peuple anglais a été considéré si longtemps comme le plus précieux des alliés du monde entier, parce qu'on sait pouvoir compter sur l'opiniâtreté farouche de son gouvernement et de la grande masse de la nation, fermement décidés à se battre jusqu'à' la victoire ; on sait qu'ils ne mesureront ni le temps ni les sacrifices et qu'ils mettront en œuvre tous les moyens. C'est pourquoi l'armement militaire momentanément existant n'a aucunement besoin d'être proportionné à celui des autres Etats.
Si l'on conçoit que le rétablissement politique de la nation allemande est une question de restauration de notre volonté de vivre, il est clair aussi que, pour asseoir cette volonté, il ne suffit pas de recourir à ceux de ses éléments qui sont déjà nationaux ; ce qu'il faut, c'est nationaliser la masse, qui est antinationale comme on le voit.
En conséquence, un mouvement jeune qui se donne pour but de rétablir l'Etat allemand dans sa souveraineté propre devra entamer une lutte sans merci pour la conquête des grandes masses.
Mais notre bourgeoisie dite « nationale s est, en général, si lamentable, sa mentalité nationale apparaît si insuffisamment développée, qu'il semble bien que nous n'ayons pas à nous attendre de ce côté à une résistance sérieuse contre une vigoureuse politique nationale extérieure et intérieure. Même si, en raison de sa myopie bien connue, la bourgeoisie allemande devait. comme jadis au temps de Bismarck, persister, à l'heure d'une délivrance prochaine, dans une attitude de résistance passive, il n'y aurait du moins pas à craindre de résistance active de sa part, en raison de sa lâcheté bien connue et même proverbiale.
Il en est autrement de la masse de nos concitoyens qui a donné dans l'internationalisme. Non seulement leur caractère fruste et quelque peu primitif les porte davantage vers la violence, mais leurs dirigeants juifs sont autrement brutaux et impitoyables. Ils briseront toute tentative de
334 relèvement de l'Allemagne, comme jadis ils ont brisé l'échine à l'armée allemande. Et surtout, grâce à leur prépondérance numérique, non seulement ils empêcheront dans cet Etat parlementaire de pratiquer une politique extérieure nationale quelconque, mais encore ils rendront impossible que l'on estime à sa juste valeur la force allemande, et que l'on apprécie, en conséquence, l'intérêt que peut présenter son alliance. Car le point faible que constitue pour nous l'existence de nos quinze millions de marxistes, de démocrates, de pacifistes, de centristes, n'est pas seulement connu de nous, il saute aux yeux de l'étranger, qui, lorsqu'il estime la valeur d'une alliance possible ou non, tient compte du poids de ce boulet encombrant. On ne s'allie pas avec un Etat dont la partie active du peuple s'oppose, au moins passivement, à toute politique extérieure résolue.
Ajoutons à cela que les dirigeants de ces partis de trahison nationale ont intérêt souvent à s'opposer, par simple souci de leur propre conservation, à tout relèvement de l'Etat, et ils s'y opposeront.
Les leçons de l'histoire ne nous permettent pas de concevoir que le peuple allemand retrouve sa situation d'autrefois, sans régler leur compte à ceux qui ont causé et consommé l'écroulement inouï de notre Etat. Car, devant le tribunal de la postérité, novembre 1918 ne sera pas regardé comme une simple trahison, mais comme une trahison envers la patrie.
Dans ces conditions, le rétablissement de l'indépendance allemande à l'extérieur est lié au premier chef au retablissement de l'esprit de décision et de volonté de notre peuple.
Mais rien qu'au point de vue technique, la pensée d'une libération allemande vis-à-vis de l'extérieur apparaît insensée, tant que la grande masse du peuple ne sera pas disposée à se mettre au service de cette pensée de liberté.
Au point de vue purement militaire, il est de lumineuse évidence, pour tout officier, que l'on ne peut pas faire une guerre avec des bataillons d'étudiants, mais qu'il faut, en plus des cerveaux d'un peuple, ses poings.
Il faut bien se représenter à cet égard que si on laisse à la classe dite intellectuelle le fardeau de la défense nationale, on dépouille la nation d'un bien qu'on ne peut plus remplacer. Les jeunes intellectuels allemands qui, dans les régiments de volontaires, ont trouvé la mort dans les
335 Flandres en 1914, ont cruellement manqué dans la suite. Ils étaient l'élite de la nation, et leur perte ne pouvait plus être compensée au cours de la guerre. Et de même que le combat ne peut être alimenté que si les bataillons d'assaut sont grossis de la masse des travailleurs, de même il est impossible de la préparer techniquement s'il ne règne dans tout notre corps social une unité profonde entretenue par une ferme volonté.
Or, notre peuple, obligé de traîner sa vie, désarmé sous les mille regards des signataires du traité de Versailles, ne peut prendre aucune mesure de préparation technique tant que la horde des ennemis de l'intérieur ne sera pas décimée et réduite à cette juiverie à qui la bassesse innée de son caractère permet de trahir tout et tout le monde pour trente pièces de monnaie. Mais celle-là, elle est réglée maintenant ! Au contraire, les millions d'hommes qui, par conviction politique, s'opposent au relèvement national nous apparaissent invincibles, du moins tant qu'on n'aura pas combattu et arraché de leur cœur et de leur cerveau la cause de leur hostilité, c'est-à-dire la conception marxiste internationale. A quelque point de vue que l'on examine la possibilité de reconquérir notre indépendance comme Etat et comme peuple, préparation politique à l'extérieur, mise en état de nos forces ou préparation de la bataille elle-même, la condition de base reste toujours, et dans tous les cas, la conquête préalable de la grande masse de notre peuple à l'idée de notre indépendance nationale.
Si nous ne regagnons pas notre liberté à l'extérieur, toute réforme intérieure, même dans le cas le plus favorable, ne représentera qu'un accroissement de notre capacité à être pour les autres nations une espèce de colonie. Les bénéfices de notre relèvement économique - ou de ce que l'on désigne sous ce nom - iront à messieurs nos contrôleurs internationaux, et toute amélioration d'ordre social réalisée chez nous augmentera à leur avantage le produit de notre travail. Quant aux progrès culturels, ils ne peuvent pas échoir en partage à la nation allemande, car ils sont trop liés à l'indépendance politique et à la dignité d'un peuple.
Si donc il n'est d'avenir pour l'Allemagne que si la grande masse de notre peuple est gagnée à l'idée nationale,
336 la conquête de cette masse constitue la tâche la plus élevée et la plus importante de notre mouvement ; et l'activité de celui-ci ne doit pas s'employer seulement à satisfaire les besoins du présent, elle doit considérer surtout dans ses réalisations les conséquences qu'elles peuvent avoir pour l'avenir du pays. C'est ainsi que, dès 1919, nous avions compris que le nouveau mouvement devait arriver avant tout à nationaliser les masses.
Il en résultait, pour la tactique à suivre, une série d'obligations.
1° Pour gagner 1a masse au relèvement national, aucun sacrifice n'est trop grand.
Quelles que soient les concessions d'ordre économique encore et toujours accordées aux ouvriers, celles-ci ne sont pas à comparer avec le bénéfice qu'en retire l'ensemble de la nation, si elles contribuent à faire entrer les grandes couches populaires dans le corps social dont elles font partie.
Seuls, des esprits myopes et bornés - comme il y en a malheureusement un si grand nombre dans nos milieux ouvriers - peuvent méconnaître qu'à la longue, aucun essor économique ne leur sera possible, et par suite profitable tant que n'aura pas été rétablie une profonde solidarité entre le peuple et la nation.
Si, pendant la guerre, les syndicats avaient protégé ardemment les intérêts des travailleurs, si, même pendant la guerre, ils avaient eux-mêmes arraché mille fois, par 1a grève, aux entrepreneurs, alors avides de dividendes, leur acquiescement aux revendications des ouvriers qu'ils opprimaient, s'ils avaient proclamé avec autant de fanatisme leur culte pour l'idée allemande, en poursuivant l'œuvre de défense nationale, et s'ils avaient donné à la patrie avec la même ardeur, poussée au paroxysme, tout ce qui est dû à la patrie, la guerre n'aurait pas été perdue. Combien toutes ces concessions économiques auraient été insignifiantes, même les plus grandes, vis-à-vis de l'importance inouïe de la victoire !
Ainsi, dans un mouvement qui cherche à rendre l'ouvrier allemand au peuple allemand, il importe de comprendre que des sacrifices économiques sont négligeables tant qu'ils ne compromettent pas la solidité et l'indépendance de l'économie nationale.
2° L'éducation nationale de la masse ne peut être réalisée
337 que par le moyen indirect du relèvement social ; c'est en effet par ce moyen seul que peuvent être obtenues les conditions économiques de base qui permettraient à chacun de prendre sa part des biens culturels de la nation.
3° La nationalisation de la masse ne peut, en aucun cas, être obtenue par des demi-mesures ou par un apostolat timide, mais par une concentration d'efforts poussés à fond, avec fanatisme, jusqu'au but qu'il importe d'atteindre. Ceci veut dire qu'on ne peut pas rendre un peuple « national », au sens très mitigé que donne à ce mot notre bourgeoisie actuelle ; il faut agir nationalement, avec toute la fougue qu'exigent les solutions extrêmes.
Le poison n'est vaincu que par le contre-poison et seuls des bourgeois insipides peuvent s'imaginer que des procédés juste-milieu les conduiront au royaume des cieux.
La grande masse d'un peuple ne se compose ni de professeurs, ni de diplomates. Elle est peu accessible aux idées abstraites. Par contre, on l'empoignera plus facilement dans le domaine des sentiments et c'est là que se trouvent les ressorts secrets de ses réactions, soit positives, soit négatives. Elle ne réagit d'ailleurs bien qu'en faveur d'une manifestation de force orientée nettement dans une direction ou dans la direction opposée, mais jamais au profit d'une demi-mesure hésitante entre les deux. Fonder quelque chose sur les sentiments de la foule exige aussi qu'ils soient extraordinairement stables. La foi est plus difficile à ébranler que la science, l'amour est moins changeant que l'estime, la haine est plus durable que l'antipathie. Dans tous les temps, la force qui a mis en mouvement sur cette terre les révolutions les plus violentes, a résidé bien moins dans la proclamation d'une idée scientifique qui s'emparait des foules que dans un fanatisme animateur et dans une véritable hystérie qui les emballait follement.
Quiconque veut gagner la masse, doit connaître la clef qui ouvre la porte de son cœur. Ici l'objectivité est de la faiblesse, la volonté est de la force.
4° On ne peut gagner l'âme du peuple que si, en même temps que l'on lutte pour atteindre son propre but, on veille à détruire tout ennemi qui cherche à y faire obstacle.
Dans tous les temps, le peuple a considéré l'attaque sans merci de ses adversaires comme la preuve de son bon
338 droit ; pour lui, renoncer à les détruire, c'est douter de ce bon droit ; c'est même nier qu'il existe.
La masse n'est qu'une partie de la nature : ses sentiments ne lui permettent pas de vivre en bonne harmonie avec des hommes qui ne se cachent pas de vouloir le contraire de ce qu'elle veut elle-même. Elle ne conçoit que la victoire du plus fort et l'anéantissement du plus faible ou tout au moins son assujettissement sans conditions.
La nationalisation de notre masse ne pourra réussir que si, outre le combat mené pour conquérir l'âme de notre peuple, on entreprend de détruire ses empoisonneurs Internationaux.
5° Toutes les grandes questions de notre temps sont des questions du moment et ne représentent que la suite de causes définies.
Une cause, entre toutes, présente pourtant seule une importance fondamentale : celle du maintien de la race dans l'organisme social. C'est dans le sang, seul, que réside la force ou la faiblesse de l'homme. Les peuples qui ne reconnaissent pas et n'apprécient pas l'importance de leurs fondements racistes ressemblent à des gens qui voudraient conférer aux caniches les qualités des lévriers, sans comprendre que la rapidité et la docilité du caniche ne sont pas des qualités acquises par le dressage, mais sont inhérentes à la race elle-même. Les peuples qui renoncent à maintenir la pureté de leur race renoncent, du même coup, à l'unité de leur âme dans toutes ses manifestations.
La dislocation de leur être est la conséquence naturelle et inéluctable de l'altération de leur sang, et la désagrégation de leurs forces spirituelles et créatrices n'est que l'effet de modifications apportées à leurs fondements racistes.
Celui qui veut délivrer le peuple allemand des imperfections manifestes qui ne sont pas inhérentes â ses origines, devra d'abord le délivrer de ceux qui l'ont poussé dans la voie de ces imperfections.
La nation allemande ne pourra plus s'élever de nouveau, si l'on n'envisage pas résolument le problème de la race, et par suite la question juive.
La question de race n'est pas seulement la clef de l'histoire du monde, c'est celle de la culture humaine.
6° L'incorporation dans une communauté nationale de la grande masse de notre peuple, qui est aujourd'hui dans
339 le camp de l'internationalisme, ne comporte aucune renonciation à l'idée que chacun défende les intérêts légitimes des gens de sa condition. Tous ces intérêts particuliers aux différentes conditions ou professions ne doivent entraîner en rien une séparation entre les classes : ce ne sont que des phénomènes résultant normalement des modalités de notre vie économique. La constitution de groupements professionnels ne s'oppose en rien à la formation d'une véritable collectivité populaire, car celle-ci consiste dans l'unité du corps social dans toutes les questions qui concernent ce corps social.
L'incorporation d'une condition, devenue une classe, dans la communauté populaire, ou seulement dans l'Etat, ne se produit pas par abaissement des classes plus élevées, mais par relèvement des classes inférieures. La bourgeoisie d'aujourd'hui n'a pas été incorporée dans l'Etat par des mesures prises par la noblesse, mais par sa propre activité et sous sa propre direction.
Le travailleur allemand n'est pas entré dans le cadre de la communauté allemande â la suite de scènes de fraternisation larmoyante, mais parce qu'il a consciemment relevé sa situation sociale et culturelle jusqu'à atteindre sensiblement le niveau des autres classes.
Un mouvement qui s'assigne un but semblable devra chercher ses adhérents d'abord dans le camp des travailleurs. Il ne doit s'adresser à la classe des intellectuels que dans la mesure où celle-ci aura saisi pleinement le but à atteindre. La marche de ce phénomène de transformations et de rapprochements de classes n'est pas une affaire de dix ou vingt ans : l'expérience conduit à penser qu'elle embrassera de nombreuses générations.
Le plus gros obstacle au rapprochement du, travailleur d'aujourd'hui et de la collectivité nationale, ce n'est pas l'action des représentants de ses intérêts corporatifs, maïs celle des meneurs qui le travaillent dans le sens de l'internationalisme dans un esprit hostile au peuple et à la patrie.
Ces mêmes associations syndicales - conduites au point de vue politique dans un sens national et franchement populaire - transformeront des millions de travailleurs en membres de haute valeur de la collectivité nationale, sans que cela influe sur les combats isolés qui pourront se livrer sur le terrain purement économique.
340 Un mouvement qui veut rendre honorablement l'ouvrier allemand à son peuple et l'arracher à l'utopie internationaliste doit s'attaquer tout d'abord avec la dernière vigueur à certaines conceptions qui règnent dans les milieux patronaux : à savoir qu'une fois entré dans la communauté populaire, l'ouvrier perdrait, au point de vue économique, ses moyens de défense vis-à-vis de son employeur ; et encore que la moindre tentative de défense des intérêts économiques vitaux dés ouvriers même les plus justifiés, est une attaque contré les intérêts de la collectivité.
Combattre une telle théorie, c'est combattre un mensonge connu ; la collectivité populaire n'impose pas ses obligations à certaines de ses parties, mais à toutes.
Sans doute, un ouvrier pèche contre l'esprit d'une collectivité populaire digne de ce nom quand, sans égards . pour le bien public et pour le maintien de l'état économique national, et appuyé sur sa force, il profère des revendications exagérées. Mais un entrepreneur ne lèse pas moins cette communauté si, par des procédés d'exploitation inhumains et par de véritables extorsions, il fait mauvais usage de la force de travail de la nation et gagne, tel un usurier, des millions sur la sueur de ses ouvriers.
Il perd ainsi le droit de se dire « national », ni de parler d'une communauté populaire, car il n'est qu'une canaille égoïste qui sème le mécontentement et provoque les luttes qui s'ensuivent, luttes qui, de toutes façons, seront nuisibles au pays.
Le réservoir dans lequel notre mouvement devra puiser en premier lieu sera donc la masse de nos ouvriers. Cette masse, il s'agit de l'arracher à l'utopie internationaliste, â sa détresse sociale, de la sortir de son indigence culturelle et d'en faire un élément décidé, valeureux, animé de sentiments nationaux et d'une volonté nationale, de notre communauté populaire.
S'il se trouve dans les milieux nationaux éclairés des hommes ardemment attachés à leur peuple et à son avenir et conscients de l'importance du combat dont l'âme de cette masse est le prix, ces hommes seront les bienvenus dans les rangs de notre mouvement. Ils en constitueront utilement la charpente spirituelle. Ceci dit, nous ne cherchons pas à attirer à nous le bétail électoral bourgeois. Car nous nous chargerions ainsi d'une masse dont la mentalité
341 aurait plutôt pour effet d'écarter de nous des couches sociales beaucoup plus étendues.
Certes, c'est théoriquement très beau de vouloir grouper dans un même mouvement les masses les plus étendues, venues d'en haut comme d'en bas. Mais il faut tenir compte de ceci : il est peut-être possible de prendre sur la classe bourgeoise une influence psychologique suffisante pour lui inculquer des opinions nouvelles ou même une saine compréhension des choses ; mais on ne peut songer à faire disparaître des qualités caractéristiques ou, disons mieux, des imperfections dont l'origine et le développement remontent à plusieurs siècles. Enfin, notre but n'est pas de modifier les esprits dans un camp qui est déjà national ; il s'agit d'amener â nous le camp des anti-nationaux.
Et c'est cette idée qui doit finalement commander toute la tactique du mouvement.
7° Cette prise de position unilatérale, et par cela même très claire, doit se retrouver aussi dans la propagande du mouvement et inversement, notre propagande s'appliquera à la développer à son tour.
Car, pour que la propagande en faveur du mouvement soit efficace, il faut qu'elle ne s'exerce que dans une direction unique ; sinon, en raison de la différence de formation intellectuelle des deux camps en présence, cette propagande serait incomprise de l'un d'eux, ou repoussée par l'autre comme portant sur des vérités évidentes et par suite sans intérêt.
Même la manière de s'exprimer et le ton que l'on prend ne peuvent porter également sur deux couches sociales si diamétralement différentes.
Si la propagande renonce à une certaine naïveté d'expression, elle ne parviendra pas à toucher la sensibilité de la masse. Si elle introduit au contraire dans ses paroles et dans ses gestes toute la rudesse de sentiments de la masse, elle n'atteindra pas les milieux dits « intellectuels ».
Parmi cent personnages qui se disent orateurs, il n'y en a pas dix qui sauraient parler avec une égale efficacité, et naturellement sur le même sujet, aujourd'hui à un auditoire de balayeurs de rues, de serruriers et de nettoyeurs de canaux et demain à des professeurs de l'enseignement supérieur et à des étudiants. J'entends leur parler sous une forme qui réponde aux possibilités d'assimilation des uns
342 et des autres, et, de plus, qui exerce sur eux la même influence et qui déchaîne chez les uns comme chez les autres la même tempête d'applaudissements.
Il faut toujours avoir présent à l'esprit que la plus belle pensée d'une théorie élevée ne peut, le plus souvent, se répandre que par l'intermédiaire de petits et même de très petits esprits.
Il ne s'agit pas de ce que pourrait dire le créateur d'une idée géniale, mais de ce que devient cette idée dans la bouche de celui qui la transmet et du succès qu'elle obtient sous cette forme.
C'est ainsi que la force d'expansion de la social-démocratie, disons plus, du mouvement marxiste, repose surtout sur l'unité et, par suite, la manière uniforme du public auquel elle s'adressait.
Plus les idées exposées paraissaient limitées, voire même bornées, plus elles étaient facilement acceptées et mises en pratique par une masse dont la capacité correspondait bien à la pâture intellectuelle qui lui était servie.
Aussi le mouvement nouveau devait-il s'engager sur une voie à la fois simple et claire :
I a propagande doit être maintenue tant pour le fond que pour la forme, au niveau de la masse, et l'on ne doit mesurer sa valeur qu'aux résultats obtenus.
Dans les réunions populaires, l'orateur qui parle le mieux n'est pas celui qui sent venir à lui l'intelligence des assistants, mais celui qui conquiert le cœur de la masse.
Un t< intellectuel » qui, dans une assemblée populaire, critiquerait mesquinement le défaut d'élévation de pensée dans un discours qui aurait manifestement agi sur les basses couches qu'il s'agissait de conquérir, ne prouverait que la complète incapacité de son jugement et le néant de sa propre valeur, eu égard au mouvement nouveau.
Il ne faut, au service de notre mouvement, que des intellectuels susceptibles de comprendre assez bien notre mission et notre but pour juger l'activité de notre propagande uniquement sur ses succès et nullement sur l'impression qu'elle a pu leur faire. En effet, la propagande n'est pas faite pour entretenir la mentalité nationale des gens qui l'ont déjà, mais pour gagner des ennemis de notre conception du peuple allemand, s'ils sont toutefois de notre sang.
En générai, les méthodes que j'ai déjà exposées somrnai-
343 rement en traitant de la propagande en temps de guerre, me paraissent parfaitement convenir à notre mouvement en raison de leurs procédés particulièrement propres à éclairer les idées.
Le succès a prouvé l'excellence de ces méthodes.
8° Le moyen de réussir un mouvement de réforme politique ne sera jamais d'éclairer ou d'influencer les forces dirigeantes : ce qu'il faut, c'est conquérir la puissance politique. Une idée qui doit bouleverser le monde a non seulement le droit, mais le devoir de s'assurer les moyens qui rendent possible l'accomplissement de ses conceptions. Le succès est le seul juge ici-bas qui décide de la justice ou de l'injustice d'une telle entreprise, et, par le mot de succès, je n'entends pas, comme en 1918, la conquête de la puissance, mais l'action bienfaisante sur le peuple entier.
Il ne faut donc pas considérer un coup d'Etat comme réussi - comme certains magistrats sans conscience le proclament aujourd'hui en Allemagne - parce que les révolutionnaires auront réussi à prendre possession du pouvoir, mais seulement si la nation, grâce à la conquête des objectifs que s'était fixés le mouvement révolutionnaire, est plus florissante que sous le régime passé. Jugement que l'on ne peut pas appliquer à la révolution allemande, comme s'intitule le coup de force des bandits de l'automne 1918.
Mais si la conquête de la puissance politique est la première condition à remplir pour pouvoir faire aboutir des intentions de réformes, alors un mouvement qui a de telles intentions doit, dès le premier jour de son existence, avoir conscience de ce qu'il est un mouvement de masse et non pas celui d'un club littéraire de buveurs de thé, ou d'une société bourgeoise de joueurs de quilles.
9° Le mouvement nouveau est dans son essence et dans son organisation intime antiparlementaire, c'est-à-dire qu'il dénie en général le principe - comme dans sa propre organisation intérieure - d'une souveraineté de la majorité en vertu de laquelle le chef du gouvernement est rabaissé au rang de simple exécutant de la volonté des autres. Le mouvement pose le principe que, sur les grandes comme sur les petites questions, le chef détient une autorité incontestée, comportant sa responsabilité la plus entière.
Les conséquences pratiques de ce principe sont pour notre mouvement :
344 Le président d'un groupement subordonné est installé dans ses fonctions par le chef du groupement d'ordre immédiatement supérieur ; il est responsable de la conduite de son groupement : toutes les commissions sont à sa disposition; inversement, il ne dépend d'aucune commission.
Aucune commission n'a droit de vote ; il n'existe que des commissions d'études, entre lesquelles le chef responsable répartit le travail. De ce principe découle l'organisation du Bezirk, du Kreis, ou de la Gau (1) ; partout le chef est institué par le chef immédiatement supérieur et il lui est en même temps dévolu une pleine autorité et des pouvoirs illimités. Seul, le chef de l'ensemble du parti est élu, selon les règles de l'association, par l'assemblée générale des membres. Mais il est le chef exclusif. Toutes les commissions sont sous sa dépendance ; il ne dépend d'aucune. Il a la responsabilité, mais la porte tout entière sur ses épaules. Si le chef a violé les principes du mouvement ou s'il a mal servi ses intérêts, il appartient â ses partisans de le faire comparaître sur le forum en vue d'une nouvelle élection et de le dépouiller de sa charge. Il est alors remplacé par l'homme nouveau qui semble le plus capable et qui est, à son tour, revêtu de la même autorité et de la même responsabilité.
C'est un des devoirs les plus stricts de notre mouvement que de considérer ce principe comme impératif, non seulement dans ses propres rangs, mais dans le cadre de l'Etat tout entier.
Celui qui veut être le chef porte, avec l'autorité suprême, et sans limites, le lourd fardeau d'une responsabilité totale. Celui qui n'est pas capable de faire face aux conséquences
de ses actes, ou qui ne s'en sent pas le courage, n'est bon à rien comme chef. Seul un héros peut assumer cette fonction.
Les progrès et la civilisation de l'humanité ne sont pas un produit de la majorité, mais reposent uniquement sur le génie et l'activité de la personnalité.
Pour rendre à notre peuple sa grandeur et sa puissance, il faut tout d'abord exalter la personnalité du chef et la rétablir dans tous ses droits.
De ce fait, le mouvement est antiparlementaire ; et même
(1) Arrondissement, cercle, région.
345 s'il s'occupe d'une institution parlementaire, que ce ne soit que pour s'y attaquer en vue d'éliminer un rouage politique dans lequel nous devons voir l'un des signes les plus nets
de la décadence de l'humanité.
10° Le mouvement se refuse à prendre position dans des questions qui sortent du cadre de son travail politique ou qui ne paraissent pas d'une importance fondamentale.
Son but n'est pas une réforme religieuse, mais une réorganisation politique de notre peuple. Il voit dans les deux confessions religieuses des appuis également précieux pour la conservation de notre peuple ; il combat donc les partis qui contestent à la religion son rôle fondamental de soutien moral pour n'en faire qu'un instrument à l'usage des partis.
La mission du mouvement n'est pas de rétablir une forme d'Etat déterminée ni de lutter contre une autre forme d'Etat, mais d'établir les principes fondamentaux sans lesquels ni république ni monarchie ne peuvent durer.
Elle n'est ni de fonder une monarchie, ni de renforcer la république, mais de créer un Etat germanique.
La forme extérieure à donner à cet Etat pour couronner l'œuvre ne présente pas une importance fondamentale ; c'est une affaire à régler plus tard d'après l'opportunité pratique du moment.
Chez un peuple qui aura enfin compris les grands problèmes et les grands efforts inhérents à son existence, la question de la forme du gouvernement ne doit plus soulever de luttes intérieures.
La question de l'organisation intérieure du mouvement est une question, non de principe, mais d'adaptation opportune au but poursuivi.
La meilleure organisation n'est pas celle qui introduit entre le chef d'un mouvement et ses partisans un imposant système d'intermédiaires : c'est celui qui en crée le moins possible. Car organiser, c'est transmettre à un très grand nombre d'hommes une idée définie - qui toujours a pris naissance dans la tête d'un seul - et assurer ensuite la transformation de cette idée en réalités.
L'organisation n'est donc, en tout et pour tout, qu'un mal nécessaire. Elle est, tout au plus, un moyen d'atteindre un certain but ; elle n'est pas le but.
Puisque le monde produit plus de créatures machinales
346 que de cerveaux pensants, il est toujours plus facile de mettre sur pied une organisation que de donner corps à des idées. Le stade d'une idée en voie de réalisation, en particulier lorsqu'elle présente un caractère de réforme, est, à grands traits, le suivant :
Une idée géniale sort toujours du cerveau d'un homme en qui s'éveille la vocation de transmettre sa foi au reste de l'humanité. Il prêche ce qu'il a conçu et se gagne peu à peu un certain nombre de partisans.
La transmission directe et personnelle des idées d'un homme à ses semblables est le procédé idéal ; c'est aussi le plus naturel. A mesure que s'accroît le nombre des adeptes, Il devient de plus en plus difficile, pour celui qui répand l'idée, de continuer à agir personnellement et directement sur ses innombrables partisans, de les commander et de les guider tous. Et, de même qu'au fur et à mesure de l'extension d'une commune, la circulation pure et simple d'un point à un autre doit faire l'objet d'une réglementation, de même il faut se résoudre ici à créer des rouages encombrants. C'en est fait de l'Etat idéal : il va connaître le mal nécessaire de l'organisation. Il faut envisager la formation de petits groupes subordonnés, comme, par exemple, dans le mouvement politique, où les groupes locaux sont les cellules élémentaires des organisations d'ordre plus élevé.
Toutefois, on risquerait d'altérer l'unité de l'enseignement, si !'on consentait à ces fractionnements avant que 1 autorité du créateur de la doctrine et de l'école qu'Il a fondée soit incontestablement assise. On n'attachera jamais trop d'importance à l'existence d'un centre politique et géographique où soit la tête du mouvement.
Les voiles noirs de la Mecque ou le charme magique de Rome donnent à la longue aux mouvements dont elles sont les sièges, une force faite d'unité intérieure et de soumission à l'homme qui symbolise cette unité.
Aussi, lorsqu'on crée les cellules élémentaires de l'organisme, ne doit-on jamais négliger de maintenir toute l'importance du lieu d'origine de l'idée et d'en relever hautement le prestige.
Cette exaltation sans limite au triple point de vue symbolique, moral et matériel, du lieu d'où est sortie l'idée et où se tient la direction du mouvement, doit être poursuivie dans la mesure même où la multiplication infinie des cellules
347 subordonnées du mouvement exigent de nouveaux groupements dans l'exemple de l'organisation.
Car si le nombre croissant des adeptes, et l'impossibilité de continuer à entretenir avec eux des rapports directs, conduit à constituer des groupes subordonnés, de même la multiplication infinie de ces groupes oblige à les réunir en groupements d'ordre plus élevé que l'on pourrait qualifier par exemple, au point de vue politique, d'association de région ou de district.
Il est relativement facile de maintenir les groupes locaux les plus bas de la hiérarchie sous l'autorité du centre du mouvement : par contre, il faut reconnaître toute la difficulté d'imposer cette autorité aux organisations d'ordre plus élevé qui se constituent par la suite. Et cependant cela est fondamental pour la sauvegarde de l'unité du mouvement et par suite de l'exécution de l'idée.
Si, de plus, ces organismes intermédiaires plus importants se groupent entre eux, on voit encore s'accroître la difficulté d'assurer partout l'obéissance absolue aux ordres venus des organes centraux.
Aussi les rouages complets d'une organisation ne doivent-ils être mis en route que dans la mesure où l'autorité spirituelle de l'organe central, et de l'idée qui l'anime, paraît garantie sans réserve. Dans les systèmes politiques, cette garantie ne semble être complète que si le pouvoir a été effectivement pris.
Il en résulte que les directives pour l'aménagement intérieur du mouvement sont les suivantes :
a) Concentration de tout le travail, d'abord dans une ville unique : Munich. Rassemblement en ce point d'un groupe de partisans complètement sûrs ; création d'une école pour l'extension ultérieure de l'idée. Il faut gagner l'autorité nécessaire pour l'avenir en réalisant, en ce même endroit, les succès les plus considérables et les plus frappants qui puissent être obtenus.
Pour faire connaître le mouvement et ses chefs, il fallait non seulement ébranler visiblement la conviction que l'école marxiste fonctionnant là était invincible, mais prouver la possibilité d'un mouvement opposé.
b) Ne créer autre part des groupes locaux qu'une fois l'autorité de l'organisme de commandement de Munich définitivement assurée.
348 c) Constituer ensuite des associations de districts de région ou de pays, non pas tant lorsque le besoin s'en sera fait sentir qu'après que l'on aura obtenu des garanties suffisantes de soumission complète à l'organe central.
De plus, la création d'organismes subordonnés dépend du nombre d'individus que l'on juge capables de leur être éventuellement envoyés comme chefs.
Sur ce point, il y a deux solutions :
a) Le mouvement dispose des moyens financiers nécessaires pour attirer et instruire les hommes intelligents capables de devenir plus tard des chefs. Il met alors à la besogne le personnel ainsi acquis à la cause et l'emploie méthodiquement, en l'adaptant étroitement au but à atteindre, notamment en ce qui concerne la tactique à pratiquer.
Cette solution est la plus facile et la plus rapide : elle suppose pourtant de grands moyens pécuniaires, car ce matériel de chefs n'est en situation de travailler pour le mouvement que s'il est rétribué.
b) Par suite de son manque de ressources financières, le mouvement n'est pas en mesure d'employer des chefs fonctionnaires ; il est réduit à faire appel à des hommes qui travaillent pour l'honneur.
Cette voie est la plus longue et la plus difficile. La direction du mouvement doit parfois laisser en friche de vastes régions, lorsqu'elle ne dispose, parmi ses partisans, d'aucun homme capable d'organiser et de diriger l'action dans la région en question.
Il peut arriver que de vastes territoires ne présentent aucune ressource à cet égard, tandis que d'autres localités posséderont deux ou trois hommes d'une capacité presque égale. Les difficultés qui peuvent se présenter de ce chef sont considérables et ne peuvent être résolues qu'au bout de plusieurs années.
Mais la condition première, pour constituer un élément de l'organisation, est et reste de mettre à sa tête l'homme qui convient.
Autant une troupe sans officier serait dépourvue de valeur, autant une organisation politique est inopérante si elle n'a pas le chef qu'il lui faut.
Si l'on ne dispose pas d'une personnalité à mettre à la tête d'un groupe local, il vaut mieux s'abstenir de le constituer que d'échouer dans son organisation.
349 Pour être un chef, il ne suffit pas d'avoir de la volonté, il faut aussi des aptitudes : mais la force de volonté et l'énergie passent avant le génie tout seul. Le meilleur chef est celui ,: qui réunit la capacité, l'esprit de décision et l'opiniâtreté dans l'exécution.
L'avenir d'un mouvement est conditionné par le fanatisme et l'intolérance que ses adeptes apportent à le considérer comme le seul mouvement juste, très supérieur à toutes les combinaisons de même ordre.
C'est une très grande erreur de croire que la force d'un mouvement croît par son union avec un mouvement analogue. Il y aura peut-être un accroissement de développement extérieur qui, aux yeux d'un observateur superficiel, semblera un accroissement de force : en réalité, le mouvement aura recueilli les germes d'un affaiblissement intérieur qui ne tardera pas à se faire sentir.
Car, quoi que l'on puisse dire de la ressemblance de deux mouvements, il n'y a jamais similitude. Sinon il n'y aurait pas deux mouvements, il n'y en aurait qu'un seul. De plus, en quelque point que puissent être les différences - ne serarent-elles fondées que sur la valeur différente des deux chefs - elles sont là. La loi naturelle de tous les développements ne comporte pas l'accouplement de deux organismes différents, mais la victoire du plus fort et l'exploitation méthodique de la force du vainqueur, qui n'est rendue possible que par le combat qu'elle provoque.
L'union de deux partis politiques qui se ressemblent peut produire des avantages politiques passagers : mais, à la longue, un succès obtenu ainsi devient une cause de faiblesses qui se manifesteront plus tard.
Un mouvement ne peut devenir grand que s'il développe sans limite sa force intérieure et s'il s'accroît de façon durable en remportant une victoire définitive sur tous ses concurrents.
Sans aucun doute, on peut dire que sa force et, avec elle, son droit â la vie ne se développent qu'autant qu'il admet comme condition d'extension l'idée de se battre ; on peut dire aussi que le moment où un mouvement aura atteint sa force maxima est celui où la victoire complète se sera rangée â son côté.
Un mouvement ne demandera donc la victoire qu'à une tactique qui, loin de lui procurer des succès immédiats mais
350 momentanés, lui imposera une longue période de croissance et de longs combats provoqués par son intolérance absolue vis-à-vis des autres.
Des mouvements qui ne doivent leur croissance qu'à une soi-disant association d'organismes semblables, c'est-à-dire qu'à des compromis, ressemblent à des plantes de forceries.
Elles prennent de la hauteur, mais il leur manque la force de braver les siècles et de résister à la violence des tempêtes.
La puissance de toutes les grandes organisations qui incarnaient une grande idée a reposé sur le fanatisme avec lequel elles se sont dressées, intolérantes, sûres de leur bon droit et confiantes dans la victoire contre tout ce qui n'était pas elles.
Quand une idée est juste par elle-même, et que, armés de cette conviction, ses adeptes entreprennent de combattre pour elle ici-bas, ils sont invincibles ; toute attaque contre eux ne fait qu'accroître leur force.
Le christianisme n'est pas devenu si grand en faisant des compromis avec les opinions philosophiques de l'antiquité à peu près semblables aux siennes, mais en proclamant en défendant avec un fanatisme inflexible son propre enseignement.
L'avance apparente que des mouvements politiques peuvent réaliser en s'alliant à d'autres est rapidement dépassée par les progrès d'un enseignement qui s'organise et qui combat lui-même dans la plus complète indépendance.
Le mouvement doit dresser ses membres à ne pas voir, dans la lutte, un élément secondaire et négligeable, mais le but lui-même. Dès lors, ils ne craindront plus l'hostilité de leurs adversaires ; au contraire, ils sentiront en celle-ci la condition première de leur propre raison d'être. Ils ne redouteront pas la haine des ennemis de notre peuple et de notre conception du monde ; ils la désireront au contraire, ardemment ; mais, parmi les manifestations de cette haine, figurent le mensonge et la calomnie.
Celui qui n'est pas combattu dans les journaux juifs, celui qu'ils ne dénigrent pas, n'est ni un bon Allemand, ni un véritable national-socialiste ; sa mentalité, la loyauté de sa conviction et la force de sa volonté ont pour exacte mesure l'hostilité que lui oppose l'ennemi mortel de notre peuple.
Il faut encore et toujours signaler aux partisans de notre mouvement, et plus généralement, au peuple entier, que les journaux juifs sont un tissu de mensonge.
351 Même quand un Juif dit la vérité, c'est dans le but précis de couvrir une plus grande tromperie ; dans ce cas encore, il ment donc sciemment. Le Juif est un grand maître en mensonges : mensonge et tromperie sont ses armes de combat.
Toute calomnie, toute calomnie d'origine juive marque nos combattants d'une cicatrice glorieuse.
Celui qu'ils dénigrent le plus, est davantage des nôtres ; celui à qui ils vouent la haine la plus mortelle est notre meilleur ami.
Celui qui, le matin, lit un journal juif où il n'est pas calomnié, doit penser que la veille, il a perdu sa journée ; s'il l'avait bien employée, le Juif l'aurait poursuivi, dénigré, calomnié, injurié et sali. Et seul celui qui marche contre cet ennemi mortel de notre peuple et de toute humanité ou civilisation aryenne, a le droit de s'attendre â être en butte aux calomnies et à l'hostilité de cette race.
Quand ces principes seront bien passés dans le sang et dans la moelle de nos partisans, notre mouvement sera inébranlable et invincible.
Notre mouvement doit développer par tous les moyens le respect de la personnalité. On n'y doit jamais oublier que c'est dans la valeur personnelle que repose la valeur de tout ce qui est humain, et que toute idée et toute action sont le fruit de la force créatrice d'un homme. On n'y doit pas oublier non plus que l'admiration pour ce qui est grand n'est, ne représente pas seulement un tribut de reconnaissance à la grandeur, mais aussi un bien qui enlace et unit tous ceux qui éprouvent cette même reconnaissance.
La personnalité n'est pas remplaçable. Cela est surtout vrai quand, au lieu d'incarner une force mécanique, elle incarne l'élément culturel et créateur. Un maître illustre ne peut pas être remplacé : nul autre ne peut entreprendre de terminer son œuvre après sa mort ; il en est de même d'un grand poète, d'un grand penseur, d'un grand homme d'Etat et d'un grand général.
Car leur œuvre a germé sur le terrain de l'art ; elle n'a pas été fabriquée par une machine ; elle a été un don naturel de la grâce divine.
Les plus grandes révolutions et les plus grandes conquêtes des hommes sur cette terre, leurs plus grandes œuvres culturelles, les résultats immortels qu'ils ont obtenus comme
352 chefs de gouvernements, etc., tout cela est pour l'éternité indissolublement lié à un nom, et restera symbolisé par ce nom. Renoncer à rendre hommage à un grand esprit, c'est se priver d'une force immense, celle qui émane des noms des hommes et des femmes qui ont été grands.
Les juifs le savent très bien. Eux précisément dont les grands hommes n'ont été grands que dans leurs efforts destructifs contre l'humanité et la civilisation, cultivent cette admiration idolâtre. Mais ils essaient de la présenter comme indigne et la stigmatisent du nom de « culte de l'individualité ».
Si un peuple est assez lâche pour se rallier â cette opinion impudente et présomptueuse des Juifs, il renonce â la plus grande des forces qu'il possède : car c'est une force que de respecter un homme de génie, ses conceptions, ses œuvres ; ce n'en est pas une de respecter la masse.
Quand des cœurs se brisent, quand des âmes désespèrent, alors des ombres du passé sortent ceux qui ont su faire reculer jadis la détresse et les inquiétudes humaines, l'outrage et la misère, la servitude intellectuelle et la contrainte corporelle : ils laissent tomber leurs regards sur les mortels désespérés et leur tendent leurs mains éternelles. Malheur au peuple qui a honte de les saisir.
* Lorsque nous avons commencé à lancer notre mouvement, nous avons eu surtout à souffrir de ce que notre nom ne disait rien à personne ou n'éveillait pas une signification précise ; cette incertitude du public à notre égard compromettait notre succès.
Pensez donc : six ou sept hommes, des inconnus, des pauvres diables, se rassemblent avec l'intention de créer un mouvement dans le but de réussir là où, jusqu'à présent, de grands partis englobant des masses considérables ont échoué : reconstituer un Reich allemand possédant une force et une souveraineté plus étendues. Si l'on s'était moqué de nous ou si l'on nous avait attaqués, nous en aurions été enchantés, mais il était tout à fait déprimant de passer complètement inaperçus, comme f était le cas ; et c'est ce dont je souffrais le plus.
Quand j'entrai dans l'intimité de ces quelques hommes, il ne pouvait encore être question ni d'un parti, m d'un mouvement.
353 J'ai déjà relaté mes impressions sur mon premier contact avec ce petit cercle. J'eus alors, au cours des semaines suivantes, le temps et l'occasion d'étudier comment ce soi-disant parti pourrait se manifester et cela ne semblait pas possible à bref délai. Vrai Dieu ! le tableau en était alors angoissant et décourageant ! Il n'y avait rien, mais absolument rien encore ! Le parti n'existait que de nom et en fait, la commission qui comprenait l'ensemble de tous les membres était précisément ce que nous voulions combattre : un parlement... en miniature ! Là aussi régnait le système du vote, et si au moins, dans les grands parlements, on s'égosille pendant des mois sur des problèmes plus importants, dans notre petit cénacle la réponse à faire à une lettre reçue provoquait déjà un interminable dialogue !
Bien entendu, le public ne savait rien de tout cela. Ame qui vive, à Munich, ne connaissait le parti, même de nom, en dehors de ses quelques adeptes et de leurs rares relations.
Tous les mercredis, nous avions, dans un café de Munich, ce que nous appelions une séance de la commission, et une fois par semaine une soirée de conversations. Comme tout le parti faisait partie de la commission, les assistants étaient naturellement toujours les mêmes. Aussi s'agissait-il désormais de faire éclater notre petit cercle hors de ses limites, de gagner de nouveaux adhérents et, avant tout, de faire connaître à tout prix le nom du mouvement.
Voilà comment nous nous y prîmes : chaque mois, et, plus tard, tous les quinze jours, nous essayions de tenir une assemblée. Les invitations à y assister étaient écrites à la machine ou à la main et nous portions nous-mêmes les premières qui furent distribuées. Chacun s'adressait à son cercle de connaissances pour attirer l'un ou l'autre à nos réunions. Le succès fut lamentable.
Je me souviens encore du soir où ayant porté moi-même quatre-vingts de ces billets, nous attendions les masses populaires qui devaient venir.
Avec une heure de retard, le « président » de « l'assemblée b dut enfin ouvrir la séance. Nous étions encore sept, toujours les mêmes.
Nous en vînmes à faire polycopier nos billets à la machine par une maison de matériel de bureau de Munich ; cela nous valut le succès qu'à l'assemblée suivante il y eut
354 quelques auditeurs en plus. Puis leur nombre s'éleva lentement de 11 à 13, à 17, à 23 et enfin à 34 auditeurs.
Grâce à de très modestes quêtes faites dans notre cercle de pauvres diables, nous pûmes rassembler les fonds nécessaires pour faire enfin insérer l'annonce d'une assemblée dans le Münchener Beobachter, qui était alors indépendant. Cette fois, le succès fut vraiment étonnant.
Nous avions préparé la réunion à la « Hofbraühaus Keller » à Munich (qu'il ne faut pas confondre avec la salle des fêtes de la « Hofbraühaus » de Munich). C'était une petite salle pouvant contenir au plus 130 personnes. Elle me sembla une halle immense et nous tremblions tous de ne pas pouvoir, au soir fixé, remplir de public ce puissant édifice.
A 7 heures, il y avait 111 personnes et la séance fut ouverte.
Un professeur de Munich fit le rapport et je devais, comme deuxième orateur, prendre pour la première fois la parole en public.
Cela paraissait très audacieux au premier président du parti, alors M. Harrer ; c'était, par ailleurs, un homme très sincère et il était alors persuadé que, si j'avais d'autres aptitudes, je n'avais pas celle de la parole.
Même dans la suite il n'y eut pas moyen de le faire revenir sur cette opinion.
Mais il se trompait. Vingt minutes m'avaient été accordées dans cette première réunion, que l'on peut appeler publique, pour conserver la parole : je parlai pendant trente minutes. Et ce que j'avais simplement senti au fond de moi-même, sans en rien savoir, se trouva confirmé par la réalité : je savais parler !
Au bout de trente minutes, toute la petite salle était électrisée et l'enthousiasme se manifesta tout d'abord sous cette forme que mon appel à la générosité des assistants nous rapporta 300 marks, ce qui nous ôtait une grosse épine du pied. Car la précarité de nos moyens financiers était alors telle que nous ne pouvions même pas faire imprimer des instructions à l'usage du parti, ni faire paraître de simples feuilles volantes. Désormais, nous possédions un petit fonds, grâce auquel nous pourrions continuer à lutter énergiquement pour obtenir au moins ce qui nous manquait le plus.
355 Mais le succès de cette première assemblée de quelque importance fut, à un autre point de vue, très fécond.
J'avais déjà commencé à amener à la commission un certain nombre de jeunes forces fraîches. Pendant la longue durée de mon service militaire, j'avais fait la connaissance d'un assez grand nombre de bons camarades, qui commençaient alors lentement, sur mes appels, à adhérer au mouvement.
Ce n'étaient que des jeunes gens, des exécutants habitués à la discipline et qui rapportaient du service militaire cet excellent principe que rien n'est impossible et qu'on peut toujours arriver à ce qu'on veut.
L'importance d'un tel afflux de sang nouveau m'apparut au bout de quelques semaines de collaboration.
Le premier président du parti à ce moment, M. Harrer, était journaliste, et, comme tel, doué d'une instruction étendue. Mais, pour un chef de parti, il avait une tare très grave : il ne savait pas parler aux foules. Il se donnait en toute conscience un mal énorme ; mais il lui manquait le grand élan, et cela précisément peut-être en raison de l'absence totale, dont il souffrait, de grands dons oratoires.
M. Drexler, alors président du groupe local de Munich, était un simple ouvrier ; lui non plus n'existait pas comme orateur ; par ailleurs, il n'avait été soldat ni en temps de paix, ni pendant la guerre, en sorte que, déjà faible et hésitant dans toute sa personne, il lui manquait d'avoir été formé à la seule école qui sache transformer en hommes les êtres de nature délicate, dépourvus de confiance en soi. Tous deux étaient taillés dans le même bois, incapables non seulement d'avoir au cœur la foi fanatique dans la victoire du mouvement, mais encore de briser, avec une volonté et une énergie inébranlable, les obstacles qui pouvaient s'opposer à la marche de l'idée nouvelle. Une telle tâche ne pouvait convenir qu'à des hommes dont le corps et l'âme, rompus aux vertus militaires, répondaient â ce signalement : agiles comme des lévriers, coriaces comme du cuir, durs comme de l'acier Krupp.
J'étais encore moi-même soldat : pendant près de six ans, j'avais été travaillé extérieurement et intérieurement, en sorte qu'au début, je me sentais tout à fait étranger dans un nouveau milieu. A moi aussi, on avait désappris de dire : « ça ne va pas » ou « ça ne peut pas marcher » ou « On ne
356 peut pas risquer ça », « C'est encore trop dangereux », etc.
Certes, l'affaire était dangereuse, sans aucun doute. En 1920, c'était tout simplement impossible, dans beaucoup de régions de l'Allemagne, de réunir une assemblée qui osât faire appel aux grandes masses, et d'inviter ouvertement le public à y venir. Ceux qui auraient participé à une telle réunion auraient été dispersés, battus, chassés, la tête en sang.
Aussi très peu de gens étaient-ils tentés par une telle prouesse. Dans les plus grandes réunions dites bourgeoises, les assistants avaient coutume de se disperser et de se sauver comme des lièvres devant un chien à l'apparition d'une douzaine de communistes.
Mais si les rouges ne prêtaient guère attention à des clubs de bourgeois bavards, dont le caractère profondément candide et, par suite, l'inocuité leur étaient bien mieux connus qu'aux intéressés eux-mêmes, ils étaient, au contraire, décidés à liquider par tous les moyens un mouvement qui leur paraissait dangereux. Or ce qui, dans tous les temps, a agi le plus efficacement, c'est la terreur, la violence.
Les imposteurs marxistes devaient haïr au plus haut point un mouvement dont le but avoué était la conquête de cette masse qui, jusqu'à présent, était au service exclusif des partis juifs et financiers marxistes internationaux.
Déjà le titre : « Parti ouvrier allemand » les excitait fort. On pouvait en déduire aisément qu'à la première occasion, il se produirait une violente rupture avec les meneurs marxistes, encore ivres de leur victoire.
Dans le petit cercle du mouvement d'alors, on redoutait un peu un tel combat. On voulait se risquer le moins possible en public de peur d'être vaincus. On voyait déjà, par la pensée, les résultats de notre première grande assemblée réduits à néant et le mouvement peut-être détruit pour toujours. J'étais dans une situation délicate avec ma doctrine que l'on ne doit pas éluder le combat, mais le rechercher, et revêtir à cet effet l'équipement qui, seul, assure la protection contre la violence. La terreur ne se brise pas avec l'esprit, mais par la terreur. A ce point de vue, le succès de notre première assemblée confirmait mon sentiment : on en prit courage pour organiser une deuxième assemblée d'une certaine importance.
Elle eut lieu en octobre 1919 à la Eberlbraükeller -
357 Thème, Brest-Litowsk et Versailles - quatre orateurs prirent la parole. Je parlai pendant près d'une heure, et mon succès fut plus grand que la première fois. Le nombre des auditeurs était monté à plus de 130. Une tentative de troubler la séance fut étouffée instantanément par mes camarades.
Les fauteurs de désordre prirent la fuite et descendirent l'escalier avec des bosses sur la tête.
Quinze jours après, une nouvelle assemblée eut lieu dans la même salle, en présence de plus de 170 assistants. La pièce était pleine. Je pris encore la parole, et mon succès fut encore plus grand.
Je cherchai une autre salle : nous en trouvâmes enfin une à l'autre bout de la ville au « Reich allem3nd u, dans la rue de Dachau. La première assemblée dans ce nouveau local eut moins de visiteurs que la précédente : à peine 140 personnes.
L'espérance recommença à baisser dans la commission ; les pessimistes s'imaginèrent que la cause de cette diminution du nombre des assistants était la répétition trop fréquente de nos « manifestations ». Nous en discutâmes abondamment et je soutins qu'une ville de 700.000 habitants pouvait bien donner lieu non pas à une réunion tous les quinze jours, mais à dix par semaine ; qu'il ne fallait pas se laisser décourager par les insuccès ; que nous étions dans la bonne voie et que, tôt ou tard, notre opiniâtreté et notre constance nous assureraient la victoire. Du reste, toute cette période de l'hiver 1919-1920 ne fut qu'un seul et même combat livré pour inspirer toujours plus de confiance dans le mouvement naissant, et dans l'efficacité victorieuse de la violence, et pour que cette confiance devienne un fanatisme capable, comme la foi, de soulever des montagnes.
La prochaine assemblée qui se tint dans la même salle me donna encore raison. Le nombre des visiteurs dépassa 200 ; et le succès apparent fut aussi brillant que le succès financier.
Je me mis aussitôt en devoir de monter une nouvelle réunion. Elle eut lieu moins de quinze jours après, et la foule des auditeurs dépassa 270 personnes.
Quinze jours après nous convoquions pour la septième fol3 nos partisans et des amis du nouveau mouvement : le même local ne pouvait plus que difficilement suffire, nous avions plus de 400 personnes à recevoir.
C'est à ce moment que nous entreprîmes de donner au
358 jeune mouvement sa constitution intérieure. Notre petit cercle entendit sur ce sujet des discussions souvent assez vives.
De divers côtés - déjà, alors, et cela dure toujours - on critiquait que notre nouveau mouvement fût appelé « un parti ». J'ai toujours vu dans cette préoccupation une preuve de l'incapacité et de l'étroitesse d'esprit des gens qui s'y livraient. C'étaient, et ce sont toujours les hommes qui ne savent pas distinguer le fond de la forme, qui cherchent à donner de la valeur à un mouvement, en l'affublant d'un nom aussi ampoulé et aussi sonore que possible, ce à quoi le trésor linguistique de nos ancêtres se prête au mieux pour notre malheur.
Il était alors difficile de faire comprendre aux gens que tout mouvement qui n'a pas encore fait triompher ses idées, et par là même atteint son but, est toujours un parti, même s'il s'attribue avec insistance un autre nom.
Si un homme quelconque veut assurer la réalisation pratique d'une idée hardie dont la mise en œuvre lui paraît devoir être utile à ses contemporains, il devra tout d'abord chercher des partisans prêts à entrer en action pour soutenir ses desseins. Et si ces desseins se limitent à détruire le parti au pouvoir et à mettre fin à l'émiettement des forces, tous les gens qui se rallieraient à cette conception et qui proclameraient les mêmes intentions seraient du même part~, tant que le but ri aurait pas été atteint. Ce n'est que le plaisir de chicaner sur les mots et de faire ses grimaces qui peut pousser quelqu'un de ces théoriciens en perruques - dont les succès pratiques sont en raison inverse avec leur sagesse - à vouloir changer une étiquette en s'imaginant modifier ainsi le caractère de parti, que possèdent tous les jeunes mouvements.
Au contraire :
S'il y a quelque chose qui puisse nuire au peuple, c'est ce renversement avec des pures expressions germaniques anciennes qui ne cadrent pas avec les temps présents, et qui ne représentent rien de précis, mais peuvent facilement conduire à juger l'importance d'un mouvement sur le nom qu'il porte.
C est un vrai scandale, mais l'on peut l'obtenir de nos jours un nombre incalculable de fois.
D'ailleurs, j'avais déjà dû mettre en garde, comme je l'ai
359 fait encore depuis, contre ces scoliastes « allemands populaires » ambulants dont l'œuvre positive est toujours égale à zéro et dont, par contre, la présomption dépasse toute mesure. Le jeune mouvement devait et doit encore se garder d'accueillir des hommes dont la simple référence consiste, le plus souvent, dans cette déclaration qu'ils ont combattu pendant trente ou quarante ans pour la même idée.
Si quelqu'un s'est dépensé pendant quarante ans pour ce qu'il appelle une idée, sans avoir assuré à cette idée le moindre succès et sans avoir empêché la victoire de son adversaire, il a donné la preuve de son incapacité, du fait même de ces quarante ans. Le plus dangereux est que de telles créatures ne veulent pas entrer dans le mouvement comme simples membres ; ils prétendent être accueillis parmi les chefs, seul poste, à leur avis, que mérite leur activité antique et où ils sont disposés à la continuer. Mais malheur si l'on livre un mouvement jeune à de tels hommes ! Il en est comme d'un homme d'affaires : celui qui, en quarante ans, a laissé tomber à plat une grosse maison, est incapable de fonder une nouvelle affaire : de même un Mathusalem « raciste », qui vient d'une grande idée et qui l'a brûlée, est incapable de conduire un jeune mouvement nouveau.
D'ailleurs, tous ces hommes ne viennent pas pour constituer une fraction du nouveau mouvement, pour le servir et pour travailler dans l'esprit du nouvel enseignement ; dans la plupart des cas, ils viennent assurer, une fois de plus, le malheur de l'humanité par application de leurs idées personnelles, cela sous la protection du jeune mouvement et grâce aux possibilités qu'il offre... Mais ce que peuvent bien être ces idées, c'est assez difficile à expliquer.
La caractéristique de ces créatures, c'est qu'elles rêvent des vieux héros germaniques, des ténèbres de la préhistoire, des haches de pierre de Ger et de boucliers ; ce sont, en réalité, les pires poltrons qu'on puisse imaginer.
Car ceux-là même qui brandissent dans tous les sens des sabres de bois, soigneusement copiés sur d'anciennes armes allemandes et qui recouvrent leur tête barbue d'une peau d'ours naturalisée, surmontée de cornes de taureau, ceux-là n'attaquent, quant au présent, qu'avec les armes de l'esprit, et s'enfuient en toute hâte dès qu'apparaît la moindre matraque communiste. La postérité ne s'avisera certai-
360 nement pas de mettre en épopée leurs héroïques exploits.
J'ai trop bien appris à connaître ces gens-là pour que leur misérable comédie ne m'inspire pas le plus profond dégoût.
Leur façon d'agir sur les masses est grotesque, et le Juif a toute raison d'épargner ces comédiens « racistes u et même de les préférer aux champions du futur Etat allemand. Ajoutez à cela que ces hommes ont une présomption démesurée et qu'ils prétendent, malgré toutes les preuves de leur incapacité parfaite, comprendre tout mieux que personne ; ils sont une plaie pour ceux qui se battent honorablement droit devant soi et qui estiment qu'il ne suffit pas d'applaudir les actes héroïques du passé, mais qu'il convient aussi que leurs propres actions laissent à la postérité des souvenirs aussi glorieux.
Parmi tous ces gens-là, il est souvent bien difficile de distinguer ceux qui agissent par bêtise profonde ou par incapacité et ceux qui agissent pour des raisons déterminées.
C'est ainsi qu'en particulier, j'ai toujours eu le sentiment que les soi-disants réformateurs religieux - à la vieille mode allemande - n'étaient pas suscités par des puissances désirant le relèvement de notre peuple. En effet, toute leur activité s'emploie à détourner le peuple du combat commun contre l'ennemi commun qui est le Juif ; et, au lieu de le conduire à ce combat, elle l'engage dans de funestes luttes religieuses intestines. C'est justement pour cela qu'il était utile de doter le mouvement d'une force centrale pratiquant l'autorité absolue dans le commandement.
C'est par ce moyen seul qu'il était possible d'interdire toute activité à ces éléments nocifs.
Et c'est aussi pourquoi nos Assuérus racistes sont les ennemis les plus acharnés d'un mouvement caractérisé par son unité et par la rigoureuse discipline avec laquelle il est conduit.
Ce n'est pas en vain que le jeune mouvement, s'appuyant alors sur un programme défini, avait, à cet effet, employé le mot : « raciste ». Ce mot ne peut pas en effet, de par le caractère vague de la notion qu'il exprime, servir de programme à un mouvement et il ne saurait constituer un critérium sûr d'allégeance à un tel parti.
Plus cette notion est dif6cile à définir dans la pratique, plus elle admet d'interprétations ; plus celles-ci sont différentes, plus s'accroît aussi la possibilité de s'y rallier.
361 L'introduction d'une conception si mal définie, si extensible dans un si grand nombre de directions sur le terrain politique, conduirait à supprimer toute solidarité étroite de combat.
Car il n'y a pas de solidarité, si chaque individu. conserve le soin de déterminer sa croyance, et le sens de sa volonté. Il est également honteux de voir combien de gens promènent aujourd'hui le mot « raciste u sur leur casquette, et combien de gens ont une fausse conception personnelle de cette notion. Un professeur connu, en Bavière, militant célèbre, intellectuel distingué, ayant fait maintes campagnes - également intellectuelles - contre Berlin, rapproche la notion de « raciste u de la notion de « monarchie p. Cette savante cervelle n'a oublié qu'une chose, c'est d'expliquer de plus près en quoi nos monarchies allemandes du passé sont identiques à la conception moderne de « racisme ".
Je crains bien que ce monsieur n'y arrive pas. Car on ne peut rien se représenter de moins raciste que la plupart des constitutions monarchiques. S'il en était autrement, celles-ci n'auraient jamais disparu, ou bien leur disparition prouverait que la conception universelle du raciste est fausse.
C'est ainsi que chacun parle du racisme comme il le comprend ; mais une telle multiplicité d'interprétation ne peut pas être prise comme point de départ d'un mouvement politique militant.
Je n'insisterai pas sur cette ignorance absolue de certains Jean-Baptiste annonciateurs du vingtième siècle, qui méconnaissent aussi bien le racisme que l'âme du peuple.
Elle est suffisamment démontrée par le fait que la gauche les combat par le ridicule : elle les laisse bavarder et s'en moque.
Celui qui, ici-bas, ne parvient pas à se faire haïr de ses ennemis ne me paraît guère désirable comme ami. C'est pourquoi l'amitié de ces hommes n'était pas seulement sans valeur pour notre jeune mouvement, elle lui était nuisible. Ce fut aussi la raison essentielle pour laquelle nous choisîmes d'abord le nom de « parti ». Nous étions en droit d'espérer que ce mot seul effrayerait et éloignerait de nous tout l'essaim des rêveurs « racistes ». Ce fut
362 enfin la raison pour laquelle nous nous arrêtames, en second lieu, à la désignation de parti ouvrier allemand national socialiste.
Notre première dénomination éloigna de nous les rêveurs de l'ancien temps, ces hommes aux mots creux, qui mettent en formules les « idées racistes » ; la deuxième nous délivra de toute la séquelle des chevaliers aux glaives « spirituels », de tous les gueux pitoyables qui tiennent leur « intellectualité » comme un bouclier devant leur corps tremblant.
Naturellement, ces derniers ne manquèrent pas de nous attaquer avec la plus grande violence, mais seulement avec la plume, comme il fallait s'y attendre, de la part de telles oies. A vrai dire, ils ne goûtaient pas du tout notre principe : « Nous défendre par la violence contre quiconque nous attaquerait par la violence. »
Ils ne nous reprochaient pas seulement très énergiquement d'avoir le culte brutal du gourdin, mais aussi de manquer de spiritualité. Que, dans une réunion populaire, un Démosthène puisse être réduit au silence par une cinquantaine d'idiots qui, hurlant et jouant des poings, ne veulent pas le laisser parler, cela ne touche nullement ces charlatans-là. Leur lâcheté congénitale ne les exposera jamais à un tel danger. Car ils ne travaillent pas dans la mêlée bruyante, mais dans le silence du cabinet.
Encore aujourd'hui, je ne saurais assez mettre en garde notre jeune mouvement contre les pièges que peuvent lui tendre ceux que nous appellerons les « travailleurs silencieux ». Ce sont non seulement des poltrons, mais des impuissants et des fainéants. Tout homme qui sait quelque chose, qui a perçu un danger, qui voit de ses yeux la possibilité de porter secours, a, que diable ! l'obligation stricte de ne pas s'y employer en silence, mais d'entrer publiquement en lice contre le mal pour le guérir. S'il ne le fait pas, il méconnaît son devoir, s'avère lamentablement faible et capitule par poltronnerie, paresse ou impuissance.
La plupart de ces « travailleurs silencieux » agissent comme s'ils savaient quelque chose... Dieu sait quoi ! Impuissants, ils cherchent à piper le monde entier avec
leurs tours de passe-passe. Paresseux, ils voudraient donner l'impression de déployer, dans leur travail soi-disant silencieux, une activité énorme et assidue. En un mot, ce
363 sont des magiciens, des meneurs politiques qui ne peuvent souffrir les efforts honorables des autres. Quand un de ces papillons de nuit « raciste e exalte la valeur du travailleur silencieux, on peut parier à mille contre un que son silence est complètement improductif, mais qu'il vole, oui, qu'il vole, le fruit du travail de quelques autres.
Ajoutez à cela l'arrogance et l'impudence présomptueuse avec laquelle cette racaille, carrément paresseuse et fuyant la lumière, s'empare du travail des autres et l'accable de critiques hautaines, vous apercevrez qu'en vérité, elle se fait complice de l'ennemi mortel de notre peuple.
N'importe quel agitateur qui a le courage, debout sur la table d'une auberge, entouré d'adversaires, de défendre virilement et ouvertement sa manière de voir, en fait plus que mille de ces individus sournois, menteurs et perfides. Il conquerra sincèrement l'un ou l'autre et l'amènera au mouvement. Son activité pourra être mesurée à l'épreuve du succès.
Tandis que ces charlatans et ces poltrons, qui vantent leur travail en sourdine, puis se cachent sous le voile d'un méprisable anonymat, ne sont absolument bons à rien à l'égard du relèvement de notre peuple, ce sont de véritables bourdons.
* Au début de 1920, j'entrepris d'organiser une première
assemblée véritablement grande. Ceci donna lieu à des discussions ; quelques dirigeants du parti jugeaient l'afFaire par trop prématurée et son résultat douteux. La presse rouge avait commencé à s'occuper de nous et nous étions assez satisfaits d'être arrivés à exciter sa haine. Nous avions commencé à nous manifester dans d'autres réunions, comme contradicteurs. Naturellement, chacun de nous était aussitôt réduit au silence ! Et pourtant le succès était là : on apprenait à nous connaître, et à mesure qu'on nous connaissait davantage, se déchaînaient contre nous l'aversion et la fureur. Nous pouvions donc espérer recevoir, à notre première grande réunion, la visite - sur un grand pied de nos amis du camp rouge.
Je me rendais bien compte, moi aussi, que nous risquions fort d'être démolis. Mais il fallait bien en arriver au combat et si ce n'était tout de suite, ce serait quelques mois plus tard.
364 Il ne dépendait que de nous d'assurer, dès le premier jour, la perpétuité de notre mouvement, en défendant notre position avec une confiance aveugle, par une lutte sans merci. Je connaissais assez bien - et ceci était capital la mentalité du parti rouge pour savoir qu'une résistance à outrance aurait pour premier effet, non seulement d'éveiller l'attention sur nous, mais encore, de nous gagner des partisans. Il fallait donc être décidés à cette résistance.
Le premier président du parti, alors, M. Harrer, ne crut pas pouvoir adhérer à mon opinion en ce qui concernait le choix de la date ; à la suite de quoi, agissant en homme honnête et loyal, il abandonna la direction du mouvement. A sa place surgit M. Antoine Drexler. Pour moi, j'avais conservé l'organisation de la propagande et je m'y employai désormais à fond.
La date de la réunion de la première grande assemblée populaire de notre mouvement, encore inconnu, fut fixée au 24 février 1920:
J'en dirigeai personnellement les préparatifs. Ils furent très courts. D'ailleurs, tout fut monté de manière à pouvoir prendre des décisions avec la rapidité de l'éclair. Sur des questions dont la discussion aurait demandé des journées de travail, il fallait, si l'on préparait une réunion publique, prendre position en vingt-quatre heures. L'annonce de la réunion devait se faire au moyen d'affiches et de tracts rédigés dans le sens que j'ai déjà indiqué, à grands traits, en parlant de la propagande et dont voici l'essentiel : action sur la grande masse, limitation à quelques points peu nombreux constamment repris ; emploi d'un texte concis, concentré, su par cœur et procédant par formules affirmatives ; maximum d'opiniâtreté pour répandre l'idée, patience dans l'attente des résultats.
Nous choisîmes comme couleur Ie rouge ; c'est elle qui stimule le plus et qui devait le plus vivement indigner et exciter nos adversaires, nous faire connaître ainsi d'eux, et les obliger, bon gré mal gré, à ne plus nous oublier.
La suite montra clairement qu'il y avait collusion politique, en Bavière aussi, entre les marxistes et le parti du Centre ; ceci se manifesta par le soin que le parti populaire bavarois, qui gouvernait, mit à essayer d'affaiblir, puis de paralyser l'effet de nos affiches sur les m3sses ouvrières rouges. La police, ne trouvant plus d'autre moyen de
365 s'opposer à notre propagande, s'en prit finalement à nos affiches. Elle en vint, pour plaire à ses associés rouges qui restaient silencieusement dans l'ombre et avec l'aide et à l'instigation du parti populiste soi-disant national allemand, à interdire complètement ces affiches qui avaient ramené au peuple allemand des centaines de milliers d'ouvriers égarés dans l'internationalisme.
Ces affiches qui ont été publiées en annexes dans les premières et deuxièmes éditions de ce livre, constituent le meilleur témoignage de la lutte vigoureuse que dut mener alors le jeune mouvement.
Elles montreront à la postérité le sens exact de notre volonté et la parfaite loyauté de nos intentions. Elles prouveront quel fut l'arbitraire des autorités dites nationales, lorsqu'elles se mirent en devoir d'étrangler un mouvement national qui les gênait, et par suite une récupération des grandes masses de notre peuple.
Elles contribueront également à détruire l'opinion qu'il y a en Bavière un gouvernement national ; elles établiront enfin, par leur texte même, que la Bavière nationale des années 1919 à 1923 ne fut nullement une création d'un gouvernement national, que ce fut, au contraire, le peuple qui se sentit de plus en plus conquis par l'esprit national et le gouvernement qui fut obligé de le suivre.
Les gouvernants eux-mêmes firent tout pour gêner et rendre impossibles les progrès de cet assainissement.
Il faut toutefois faire exception pour deux hommes : Le préfet de police d'alors Ernst Pöhner et son fidèle conseiller le Oberamtmann Frick étaient les seuls hauts fonctionnaires qui déjà, à cette époque, avaient le courage d'être Allemands avant d'être fonctionnaires. Parmi les autorités responsables, E. Pöhner était celui qui recherchait le moins la popularité, mais avait le plus vif sentiment de sa responsabilité vis-à-vis du peuple auquel il appartenait ; il était prêt à tout engager et à tout sacrifier, même sa propre vie, pour la résurrection du peuple allemand qu'il aimait par-dessus tout.
Il était l'empêcheur de danser en rond pour cette catégorie de fonctionnaires qui gagnent leurs appointements à obéir aux ordres du gouvernement qui les nourrit, sans nul souci de maintenir prospère le bien national qui leur a été confié, de prendre l'intérêt de leur peuple et de travailler à son indépendance.
366 Avant tout, il était de ces natures qui, à la différence de la plupart des détenteurs de l'autorité dite d'Etat, ne craignent pas l'hostilité des traîtres au peuple et au pays, mais la recherchent, comme la plus belle parure d'un honnête homme. La haine des Juifs et des marxistes, leurs campagnes de calomnies et de mensonges, furent son unique bonheur au milieu de la misère de notre peuple.
C était un homme d'une loyauté de granit, d'une pureté antique, d'une droiture allemande et pour qui la devise : « Plutôt la mort que l'esclavage » n'était pas qu'un mot, mais le cri de tout son être.
Lui et son collaborateur, le Dr. Frick, sont, à mes yeux, les seuls hommes ayant occupé une fonction d'Etat, qui puissent être considérés comme ayant participé à la création d'une nation bavaroise.
Avant l'ouverture de notre première grande assemblée, il me fallut non seulement apprêter le matériel de propagande nécessaire, mais aussi faire imprimer les directives du programme.
J'indiquerai avec plus de détails, dans la deuxième partie de ce livre, les directives que nous suivîmes plus particulièrement pour rédiger le programme. Je veux seulement préciser ici qu'il se proposa non seulement de donner au jeune mouvement sa structure et sa substance, mais aussi pour faire comprendre aux masses les buts qu'il poursuivait.
Les milieux que l'on qualifie d'éclairés ont essayé de faire de l'esprit et de railler, puis de critiquer. La justesse de notre conception d'alors a fait ressortir l'efficacité de notre programme.
J'ai vu naître depuis quelques années des douzaines de nouveaux mouvements : ils ont disparu sans laisser de trace, comme entraînés par le vent. Un seul a ténu : le parti ouvrier allemand national socialiste. Et aujourd'hui, j'ai plus que jamais la conviction, que ce parti, on peut le combattre, le paralyser, les petits ministres de parti peuvent nous interdire de parler, ils ne pourront plus empêcher la victoire de nos idées. Quand on n'arrivera même plus à se rappeler les noms des partis politiques au pouvoir aujourd'hui et de ceux qui les représentent, les bases du programme national socialiste constitueront encore les fondements d'un Etat naissant.
Les réunions que nous avions tenues pendant les quatre
367 mois qui avaient précédé janvier 1920, nous avaient permis de réunir les petits moyens dont nous avions besoin pour faire imprimer notre première brochure, notre première affiche et notre programme.
Si je termine la première partie de ce livre sur notre première grande réunion, c'est parce que cette réunion rompit le cadre étroit "de notre petite association et agit pour la première fois et de façon décisive sur le levier le plus puissant de notre époque, l'opinion publique. Je n'avais alors qu'un souci : la salle sera-t-elle pleine, ou faudra-t-il parler devant les bancs vides ? Je pensais dur comme pierre qu'il viendrait beaucoup de monde et que cette journée serait un grand succès. Tel était mon état d'âme en attendant impatiemment cette soirée.
La séance devait être ouverte à 7 h. 30. A 7 h. 15, quand je pénétrais dans la salle des fêtes de la Hofbraühaus sur le Platzl à Munich, je crus que mon cœur allait éclater de joie. L'énorme local - car il me paraissait encore énorme était plein, plus que plein. Les têtes se touchaient, il y avait près de 2.000 personnes. Et surtout, ceux à qui nous voulions nous adresser étaient justement ceux qui étaient venus.
Plus de la moitié de la salle paraissait occupée par des communistes ou des indépendants. Notre première grande manifestation était, à leur avis, vouée à une fin qu'ils comptaient amener rapidement.
Mais il en fut rapidement autrement. Quand le premier orateur eut terminé je pris la parole.
Quelques minutes après, c'était une grêle d'interruptions. De violentes collisions éclatèrent dans la salle. Une poignée de mes plus fidèles camarades de la guerre et d'autres partisans tombèrent sur ceux qui troublaient l'ordre et arrivèrent peu à peu à ramener un peu de calme. Je pus continuer à parler. Au bout d'une demi-heure, les applaudissements commençaient à couvrir sensiblement les cris et les rugissements.
Je passai alors au programme et je l'expliquai pour la première fois.
De quart d'heure en quart d'heure, les interruptions étaient de plus en plus dominées par les approbations. Lorsque enfin j'exposai à la foule, point par point, les 25 propositions et que je la priai de prononcer elle-même
368 son jugement, tous ces points furent acceptés au milieu d'un enthousiasme toujours croissant, à l'unanimité, et encore, et toujours à l'unanimité, et quand le dernier point eût ainsi atteint le cœur de la masse, j'avais devant moi une salle pleine d'hommes, unis par une conviction nouvelle, une nouvelle foi, une nouvelle volonté.
Au bout de quatre heures environ, la salle commença à se vider, la foule entassée reflua vers la porte comme une rivière aux eaux lentes et tous ces hommes se serraient et se bousculaient les uns contre les autres. Et je sentis alors qu'allaient se répandre au loin, parmi le peuple allemand, les principes d'un mouvement que l'on ne pourrait plus désormais condamner à l'oubli.
Un brasier était allumé : dans sa flamme ardente se forgerait un jour le glaive qui rendra au Siegfried germanique la liberté et à la nation allemande, la vie.
Sous mes yeux, le relèvement se mettait en marche. Et je voyais en même temps la déesse de la vengeance inexorable se dresser contre le parjure du 9 novembre 1918.
La salle se vida lentement.
Le mouvement suivit son cours.