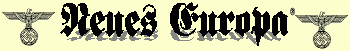
Mon Combat
ADOLF HITLER
8
Le commencement de mon activité politique
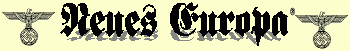
Mon Combat
ADOLF HITLER
8
Le commencement de mon activité politique
Au commencement de novembre 1918, je revins de nouveau à Munich. Je rejoignis le dépôt de mon régiment qui se trouvait aux mains de « conseils de soldats » Toute cette organisation me répugnait à tel puint que je décidai aussitôt de repartir dès que possible. J'allai avec un fidèle camarade du front, Schmiedt Ernst, à Traunstein, où je restai jusqu'à la dissolution du camp.En mars 1919, nous étions de retour à Munich.
La situation était intenable et poussait à la continuation de la révolution. La mort d'Eisner ne fit qu'accélérer l'évolution et conduisit finalement à la dictature des soviets, pour mieux dire, à une souveraineté passagère des juifs, ce qui avait été originairement le but des promoteurs de la révolution et l'idéal dont ils se berçaient.
Pendant ce temps, des plans sans nombre se pourchassaient dans ma tête. Des jours entiers, je réfléchissais à ce que je pouvais faire, mais toutes ces réflexions aboutissaient à la simple constatation que, n'ayant pas de nom, je ne remplissais pas le moins du monde les conditions pour pouvoir exercer une action utile quelconque. Je vais dire maintenant pourquoi je ne pouvais, d'autre part, me décider à adhérer à l'un des partis existants.
Au cours de cette nouvelle révolution de soviets, je me démasquai pour la première fois de telle façon que je m'attirai le mauvais œil du soviet central.
Le 27 avril 1919, je devais être arrêté, mais les trois gaillards n'eurent point le courage nécessaire en présence du fusil braqué sur eux et s'en retournèrent comme ils étaient venus.
Quelques jours après la délivrance de Munich, je fus
207 désigné pour faire partie de la Commission chargée de l'enquête sur les événements révolutionnaires dans le 2er régiment d'infanterie.
Ce fut ma première fonction active à caractère politique. Quelques semaines après, je reçus l'ordre de prendre part à un « cours n qui était professé pour tous les ressortissants de la force armée. On devait y donner au soldat des éléments définis de formation morale civique. Pour moi, toute la valeur de cette organisation consistait en ce qu'elle me donnait la possibilité d'apprendre à connaître quelques camarades partageant mes propres idées et avec lesquels j'ai été à même de discuter à fond la situation présente. Nous étions tous plus ou moins fermement convaincus que l'Allemagne ne pouvait plus être sauvée de l'écroulement imminent par les partis responsables du crime de novembre et que, d'autre part, les formations « bourgeoises nationales », même avec la meilleure volonté, ne seraient plus jamais en état de réparer le mal qui était fait. Pour cela faisait défaut toute une série de conditions sans lesquelles une pareille tâche de reconstruction ne pouvait réussir. La suite des événements a confirmé notre opinion d'alors.
Ainsi fut débattue dans notre petit cercle la formation d'un parti nouveau. Les principes que nous avions à ce moment en vue étaient les mêmes que ceux qui, plus tard, ont été mis en application dans le parti « ouvrier allemand ». Il fallait que le nom du mouvement à fonder donnât la possibilité d'accéder à la grande masse, car sans cette condition tout effort eût été inutile et superflu. Ainsi nous nous arrêtâmes au nom de « parti social-révolutionnaire », ceci parce que les idées sociales du mouvement nouveau avaient en effet le caractère d'une révolution.
Mais le motif profond en était le suivant :
Quelque approfondie qu'ait été jusque-là mon attention sur le problème économique, elle s'était plus ou moins maintenue dans les limites de l'examen des questions sociales. Plus tard seulement, mon horizon s'élargit en raison de mon étude de la politique allemande à l'égard de ses alliés. Elle était en très grande partie le résultat d'une fausse appréciation de la vie économique et du manque de clarté dans la conception des principes de l'alimentation du peuple allemand dans l'avenir. Toutes
208 ces idées reposaient dans l'idée que, dans tous les cas, le capital était uniquement le produit du travail et, par conséquent, était, comme ce dernier, modifiable par les facteurs susceptibles de favoriser ou d'entraver l'activité humaine. Donc l'importance nationale du capital résultait de ce que ce dernier dépendait de la grandeur, de la liberté et de la puissance de l'Etat, c'est-à-dire de la nation ; et cela si exclusivement que cette dépendance devait uniquement conduire le capital à favoriser l'Etat et la nation par simple instinct de conservation ou par désir de se développer. Cette orientation favorable du capital à l'égard de la liberté et de l'indépendance de l'Etat devait le conduire à intervenir de son côté en faveur de la liberté, de la puissance et de la force, etc., de la nation.
Dans ces conditions, le devoir de l'Etat à l'égard du capital devait être relativement simple et clair : il devait simplement veiller à ce que ce dernier restât au service de l'Etat et ne se figurât point être le maître de la nation. Cette position pouvait donc se maintenir entre les deux limites suivantes : d'une part, soutenir une économie nationale viable et indépendante ; d'autre part, assurer les droits sociaux du travailleur.
Précédemment, je n'étais pas. à même de reconnaître, avec la clarté désirable, la distinction entre ce capital proprement dit, dernier aboutissement du travail producteur, et le capital dont l'existence et la nature reposent uniquement sur la spéculation.
J'en étais capable dorénavant grâce à un des professeurs du cours dont j'ai parlé, Gottfried Feder.
Pour la première fois de ma vie, je conçus la distinction fondamentale entre le capital international de bourse et celui de prêt.
Après avoir écouté le premier cours de Feder, l'idée me vint aussitôt que j'avais trouvé le chemin d'une condition essentielle pour la fondation d'un nouveau parti.
* A mes yeux, le mérite de Feder consistait en ceci, qu'avec une tranchante brutalité il précisait le double caractère du capital : spéculatif, et lié à l'économie populaire ; et qu'il mettait à nu sa condition éternelle : l'intérêt. Ses déductions, dans toutes les questions fondamentales, étaient tellement
209 justes que ceux qui, a priori, voulaient le critiquer, en contestaient moins l'exactitude théorique qu'ils ne mettaient en doute la possibilité pratique de leur mise à exécution. Ainsi, ce qui, aux yeux des autres, était un point faible dans l'enseignement de Feder, représentait à mes yeux sa force.
* La tâche de celui qui établit un programme d'action n'est point d'établir les diverses possibilités de réaliser une chose mais d'exposer clairement la chose comme réalisable ; c'est-à-dire se préoccuper moins des moyens que de la fin. Ce qui décide, dans ces conditions, c'est la justesse d'une idée dans son principe, et non la difficulté de sa réalisation. Si celui qui établit un programme tient compte de ce que l'on appelle « l'opportunité » et l'efficacité au lieu de se baser sur la vérité absolue, son action cessera d'être l'étoile polaire de l'humanité tâtonnante pour devenir simplement une recette comme tant d'autres. Celui qui établit le programme d'un mouvement doit en établir le but, tandis que l'homme politique doit en poursuivre la réalisation. Donc le premier sera orienté dans sa pensée par l'éternelle vérité, tandis que l'action de l'autre dépendra plutôt des réalités pratiques du moment. La grandeur de l'un réside dans la justesse absolue au point de vue abstrait de son idée, celle de l'autre dans la juste appréciation des réalités données et leur emploi utile, dans lequel le but établi par le premier doit lui servir d'étoile directrice. Tandis que l'on peut considérer comme pierre de touche de la valeur d'un homme politique le succès de ses plans et de son action, c'est-à-dire leur application dans la réalité, au contraire la réalisation des ultimes projets du créateur de programme peut ne jamais se faire, car la pensée humaine peut concevoir des vérités et établir des buts clairs comme le cristal, mais dont l'accomplissement intégral doit échouer à cause de l'imperfection et de l'insuffisance humaines.
Plus une idée est juste au point de vue abstrait et par ce fait grandiose, plus sa réalisation intégrale reste impossible dans la mesure où elle dépend des hommes. C'est pourquoi la valeur du créateur de programme ne peut se mesurer à la réalisation de ses buts, mais à la justesse de ceux-ci et à l'influence qu'ils ont exercée sur le développement de
210 l'humanité. S'il en était autrement, les fondateurs de religion ne pourraient pas être comptés au nombre des plus grands hommes sur cette terre, car la réalisation de leurs vues éthiques ne sera jamais complète, même approximativement. Même la religion de l'amour n'est, dans son action, qu'un faible reflet des intentions de son sublime fondateur ; mais son importance réside dans l'orientation qu'elle tendait à imprimer à un développement général de la culture de la pureté des mœurs et de la morale humaine.
La très grande différence entre la mission du créateur de programme et celle du politicien est aussi le motif pour lequel la réunion des deux dans une même personne ne peut presque jamais se trouver. Ceci s'applique particulièrement aux politiciens médiocres ayant soi-disant réussi dans leur carrière, « et dont l'action n'est qu'un art des possibilités », ainsi que Bismarck définissait la politique quelque peu modestement d'ailleurs. Plus un tel homme « politique » se dégage des grandes idées, plus ses succès seront faciles et fréquents, tangibles et rapides. A la vérité, ils sont par cela même voués à l'éphémère et maintes fois ne survivent pas à la mort de leur auteur. L'œuvre de pareils hommes politiques est dans son ensemble sans valeur pour la postérité, car leurs succès dans le présent reposent sur l'étouffement de tous les problèmes et de toutes les idées réellement grandes et marquantes, qui auraient eu de la valeur pour les générations suivantes.
La poursuite de pareils buts, valables et importants pour l'avenir, est, pour celui qui combat en sa faveur, fort peu profitable et ne rencontre que rarement la compréhension des grandes masses ; les bons de bière et de lait leur paraissent beaucoup plus persuasifs que des plans d'avenir à larges vues, dont la réalisation ne peut intervenir que plus tard et dont l'utilité ne profite en somme qu'à la postérité.
Ainsi, à cause d'une certaine vanité qui est toujours apparentée à la sottise, la plus grande partie des hommes politiques s'écartent de tous les projets d'avenir présentant de réelles difficultés, afin de ne pas perdre la faveur momentanée de la grande foule. Leur succès et leur importance dépendent entièrement du présent et ils n'existent pas pour la postérité. Cela ne gêne habituellement pas les petits cerveaux ; ils s'en contentent.
211 Les conditions sont différentes pour le créateur de programme. Son importance réside presque toujours dans 1 avenir, car il n'est pas rare qu'il soit celui que l'on désigne sous le nom de « rêveur ». Car si l'art de l'homme politique est réellement considéré comme l'art des possibilités, le créateur de programme appartient à ceux dont an dit qu'ils plaisent aux dieux, seulement quand ils savent réclamer et vouloir l'impossible. Il devra toujours renoncer à la reconnaissance de ses contemporains, mais, par contre, il fait moisson de gloire pour la postérité lorsque ses idées sont immortelles.
Dans le cours de l'existence humaine, il peut arriver une fois que l'homme politiques unisse au créateur de programme. Plus ce mélange est intime, plus sont fortes les résistances qui alors s'opposent à son action. Il ne travaille plus pour des exigences évidentes, pour le premier boutiquier venu, mais pour des buts qui ne sont compris que d'une très petite élite. C'est pourquoi son existence est alors déchirée entre l'amour et la haine. La protestation de ses contemporains compense la reconnaissance future de la postérité, pour laquelle il travaille.
Car plus l'œuvre d'un homme est grande pour la postérité, moins les contemporains peuvent la comprendre ; d'autant plus dure est la lutte et d'autant plus difficile le succès. Toutefois si, su cours des siècles, le succès favorise un tel homme, il recevra peut-être au cours de sa vie même quelques pâles rayons de sa gloire future. Il est vrai que ces grands hommes ne sont que les coureurs de Marathon de l'histoire : la couronne de lauriers des contemporains n'effleure plus que les tempes du héros mourant.
On doit compter parmi eux les plus grands lutteurs de ce monde, lesquels, non compris de leurs contemporains, sont néanmoins prêts à mener le combat pour leurs Idées et leur idéal. Ils sont ceux qui, un jour, se trouveraient le plus près du cœur du peuple ; il semble presque qu'alors chacun sentira l'obligation de compenser les torts que les contemporains des grands hommes ont eus à leur égard. Leur vie et leurs actes seront étudiés dans une touchante et reconnaissante admiration et pourront relever, particulièrement dans des jours sombres, des cœurs brisés et des âmes en détresse.
A cette catégorie appartiennent non seulement les
212 hommes d'Etat réellement grands, mais aussi tous les grands réformateurs. A côté de Frédéric le Grand, se trouvent ici Martin Luther ainsi que Richard Wagner.
Lorsque j'entendis le premier cours de Gottfried Feder sur « la répudiation de la servitude de l'intérêt du capital », je compris immédiatement qu'il devait s'agir ici d'une vérité théorique d'une importance immense pour l'avenir du peuple allemand. La séparation tranchée du capital boursier d'avec l'économie nationale présentait la possibilité d'entrer en lutte contre l'internationalisation de l'économie allemande, sans toutefois menacer en même temps par le combat contre le capital les fondements d'une économie nationale indépendante. Je voyais beaucoup trop clairement dans le développement de l'Allemagne pour ne pont savoir que la lutte la plus difficile devrait être menée non contre les peuples ennemis, mais contre le capital international. Dans le cours de Feder, je pressentais un puissant mot d'ordre pour cette lutte à venir.
Et ici également, l'évolution ultérieure démontra combien juste était l'impression ressentie alors. Aujourd'hui, !es malins de notre politique bourgeoise ne se moquent plus de nous ; aujourd'hui, ils voient eux-mêmes, à moins d'être des menteurs conscients, que le capital international a non seulement le plus excité à la guerre, mais que précisément maintenant après la fin du combat, il ne manque pas de changer la paix en un enfer.
La lutte contre la finance internationale et le capital de prêt est devenue le point le plus important de la lutte de la nation allemande pour son indépendance et sa liberté économique.
Mais en ce qui concerne les objections de ce que l'on appelle les praticiens, on peut leur répondre ce qui suit : toutes les appréhensions au sujet des épouvantables conséquences économiques de la mise à exécution de la « répudiation de la servitude de l'intérêt du capital » sont superflues; car, premièrement, les recettes économiques jusqu'ici pratiquées ont fort mal tourné pour le peuple allemand, les positions prises à l'égard des questions de conservation nationale nous rappellent très fortement les avis semblables d'experts dans des temps déjà anciens, par exemple ceux de l'assemblée des médecins bavarois au sujet de la fondation des chemins de fer. Toutes les appréhensions d'alors de
213 cette illustre corporation ne se sont point ensuite réalisées, on le sait : les voyageurs du nouveau « cheval à vapeur » ri ont pas été atteints de vertige, les spectateurs ne sont pas non plus tombés malades, et l'on a renoncé aux clôtures en planches, destinées à masquer aux regards la nouvelle installation, mais des œillères sont restées devant les yeux des prétendus « experts », et cela pour toujours.
Secondement, on doit noter ce qui suit : toute idée, même la meilleure, devient un danger si elle se figure être un but par elle-même, tandis qu'en réalité, elle ne représente qu'un moyen pour atteindre un but, mais pour moi et pour tous les vrais nationaux-socialistes, il n'existe qu'une seule doctrine : peuple et patrie.
Ce qui est l'objet de notre lutte, c'est d'assurer l'existence et le développement de notre race et de notre peuple, c'est de nourrir ses enfants et de conserver la pureté du sang, la liberté et l'indépendance de la patrie, afin que notre peuple puisse mûrir pour l'accomplissement de la mission qui lui est destinée par le Créateur de l'univers.
Toute pensée et toute idée, tout enseignement et toute science, doivent servir ce but. C'est de ce point de vue que tout doit être examiné, et opportunément appliqué ou écarté. De la sorte, aucune théorie ne peut se pétrifier en une doctrine de mort, puisque tout doit servir à la vie.
Ainsi les jugements de Gottfried Feder me déterminèrent à m'occuper à fond de ce sujet avec lequel j'étais en somme encore peu familiarisé.
Je recommençai à étudier ; j'arrivai à comprendre le contenu et l'intention du travail de toute la me du juif Karl Marx. Son « capital » me devint maintenant parfaitement compréhensible, somme la lutte de la social-démocratie contre l'économie nationale, lutte qui devait préparer le terrain pour la domination du capital véritablement international et juif de la finance et de la bourse.
Mais encore à un autre point de vue, ces cours eurent sur moi une influence de la plus grande importance.
Un jour, je demandai à prendre part à la discussion. Un des participants crut devoir rompre une lance en faveur des Juifs et commença à les défendre en de longues considérations. Ceci m'incita à la contradiction. La très
214 grande majorité des participants du cours adoptèrent mon point de vue. Le résultat fut que, quelques ~ours après ï'entrai dans un des régiments alors en garnison à Munich à titre d'officier éducateur.
La discipline de la troupe était à ce moment assez faible. Elle se ressentait des efFets de la période des conseils de soldats. Ce n'est que très lentement et très prudemment que l'on pouvait entreprendre de remettre en vigueur la discipline et l'obéissance militaires, à la place de l'obéissance « librement consentie », comme on avait coutume de la désigner dans l'étable à cochons de Kurt Eisner. De même il fallait que la troupe elle-même apprît à sentir et à penser d'une façon nationale et patriotique. Dans ces deux directions s exerçait ma nouvelle activité.
Je commençai avec la plus grande joie et la plus grande ardeur. Maintenant, en effet, se présentait à moi l'occasion de parler devant un plus nombreux auditoire et ce dont j'avais toujours eu la prescience se trouvait aujourd'hui confirmé : je savais parler. Et ma voix s'était déjà suf6samment améliorée pour que je puisse être convenablement entendu partout dans une petite chambrée.
Aucune tâche ne pouvait me rendre plus heureux que celle-ci, car, avant ma libération, je pouvais rendre d'utiles services dans l'institution qui m'a toujours tenu infiniment au cœur : l'armée.
Je pourrais aussi parler de succès : j'ai ramené au cours de mon enseignement, à leur peuple et à leur patrie, plusieurs centaines de camarades. Je « nationalisais » la troupe et je pus ainsi contribuer à raffermir la discipline générale.
Je pus, par la même occasion, connaître un grand nombre de camarades partageant mes opinions, lesquels plus tard commencèrent à former avec moi le noyau principal du nouveau mouvement.